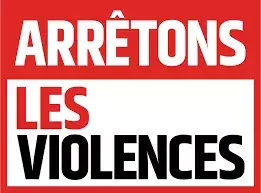Prévenir et lutter contre les violences au sein du couple
Publié le Mis à jour le |

Le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 vise à poursuivre la politique volontariste portée par le Gouvernement depuis 2017. La lutte contre les violences faites aux femmes en est le premier pilier, dans la continuité du Grenelle de lutte contre les violences conjugales.
Poursuivre la mise en œuvre des mesures du Grenelle de lutte contre les violences conjugales dans le cadre du Plan Égalité Toutes et tous égaux 2023-2027
Le Grenelle, qui s’est tenu du 3 septembre au 25 novembre 2019, a permis de renforcer et d’amplifier les actions de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple et les féminicides.
Il a mobilisé plus de 4 500 acteurs : associations, institutions, professionnels, victimes et familles de victimes, experts, administrations, élus, partenaires sociaux…11 groupes de travail et plus de 180 événements sur tout le territoire, organisés avec l’appui du réseau déconcentré des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, ont permis l'élaboration d'une feuille de route articulée autour de trois objectifs déclinés en 54 mesures.
Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations prend la parole seule face à la caméra sur le sujet des 5 ans du Grenelle des Violences.
En arrière plan à sa droite, les drapeaux de la France et de l'Union Européenne.
Discours :
"Il y a cinq ans était lancé le Grenelle des violences conjugales.
Le 3 septembre 2019, on comptait magistrats, forces de l'ordre, associations d'aide aux victimes, proches de victimes, réunies dans un but commun, éradiquer le fléau des violences faites aux femmes.
54 mesures en ont été issues, 50 sont déjà effectives.
Quelques exemples :
le 39 19 est désormais ouvert 24h/24, 7j/7, et depuis juin 2021, la plateforme téléphonique est accessible aux personnes en situation de handicap via l'application « Rogervoice ».
Un parcours renforcé de formation initiale et continue à l'accueil des femmes victimes de violences conjugales pour les policiers et gendarmes a été instauré de manière systématique pour que la parole des victimes soit accueillie et soit respectée.
En cinq ans, ce sont près de 155 000 policiers et gendarmes qui ont été formés.
Des postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries ont été créés.
Pourquoi ? Pour mieux accompagner le parcours des femmes victimes de violences au-delà du dépôt de plainte.
Nous sommes passés ainsi de 271 intervenants à 468 intervenants sociaux en cinq ans.
Le dépôt de plainte des femmes en incapacité de se déplacer a été facilité.
Par exemple, 147 conventions locales ont été conclues entre juridictions et barreaux pour mieux accompagner la victime, avec l'assistance, évidemment, d'un avocat.
Très important, la question de la suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'homicide conjugal est devenue évidemment la règle.
Elle est devenue systématique et le juge pénal peut désormais aménager ou suspendre l'autorité parentale du conjoint violent.
Nous avons aussi été le premier pays en Europe à reconnaître et à condamner sévèrement le suicide forcé.
On compte enfin 11 000 places, 11 000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, c'est le double, j'allais dire malheureusement, mais cela a été sanctuarisé par rapport à 2019.
L'accès des femmes victimes de violences à la garantie dite Visale a aussi été facilité pour leur permettre de bénéficier d'une caution locative gratuite et ainsi de trouver plus facilement un logement.
Suite à ces engagements forts de l'État, la France a obtenu des résultats.
Plus de 52 302 auteurs ont été condamnés, condamnés pour des faits de violence conjugale en 2023.
C'était un peu plus de 22 000 en 2017.
C'est une augmentation de 136 % en cinq ans, c'est dire l'accélération et la reconnaissance aujourd'hui de ces faits insupportables.
44 304 auteurs ont été sortis définitivement de leur domicile en 2023.
C'était à peine un peu plus de 11 000 en 2017.
Près de 4000 ordonnances de protection ont également été délivrées en 2023.
C'était à peine 1400 en 2017.
Et surtout, les délais dans la loi ont été significativement resserrés.
En novembre 2023, encore quelques chiffres,
5000 Téléphones Grave Danger étaient déployés dans les juridictions.
4000 ont été attribués en 2022, contre 700 en 2020.
2500 alertes ont été déclenchées en 2022 grâce à l'utilisation directe de ces Téléphones Grave Danger.
C'est là encore une augmentation très significative.
Au 1er février 2024, 1000 bracelets anti-rapprochement ont été rendus actifs.
En 2023, grâce à ces bracelets, plus de 10 000 interventions de forces de sécurité intérieure ont été déclenchées pour éviter que le conjoint violent puisse se rapprocher de sa victime.
Ces résultats ont été rendus possibles grâce à une mobilisation exceptionnelle, celle de nos administrations, des agents de l'État, des forces de l'ordre et de secours, des soignants, des personnels paramédicaux, médicosociaux, des magistrats, des élus locaux, des entreprises, des associations, des bénévoles qui, partout, se mobilisent.
Mais je sais que le travail est long encore et je voudrais conclure sur ce travail que nous devons réussir à parcourir ensemble, collectivement.
Le contrôle coercitif d'abord, qui s'impose à de trop nombreuses femmes, ces menaces voilées, cet isolement forcé, ces restrictions arbitraires dans la vie sociale, professionnelle, ces intimidations qui existent, ce flicage des victimes doit être défini et doit être réprimé dans notre code pénal.
Les signalements faits par l'administration pénitentiaire ou la victime elle-même, en cas de non-respect d'une interdiction de contact, doivent obtenir une réponse immédiate et systématique de la part du procureur, et les ordonnances de protection être délivrées de manière bien plus importante encore.
La Cour d'Appel de Poitiers, dont je veux saluer le travail exemplaire, a expérimenté le 28 août dernier une approche novatrice en rendant deux arrêts extrêmement importants.
Une demande de divorce était perdante au civil, alors qu'une procédure pour des faits de violences conjugales avait lieu en parallèle au pénal.
Eh bien, ces deux affaires ont été jugées par les mêmes magistrats, dans la même journée, afin de permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la situation.
Cette approche est une source véritable d'inspiration parce qu'elle permet évidemment de mieux protéger les victimes.
Enfin, lorsque l'auteur est déjà connu des services de police ou de justice, nous devons faire l'analyse de nos propres manquements, comprendre tout simplement ce qui nous a échappé pour que ça ne puisse pas se répéter.
Ce combat, il n'est pas solitaire, c'est celui qui doit être celui de l'ensemble de la société.
Parce qu'une femme victime de violence, ce n'est pas et ça ne doit jamais être une affaire privée.
Elle doit savoir que chacun se sent concerné, qu'il y a des professionnels formés, des environnements professionnels accueillants et toute une chaîne judiciaire, police, gendarmerie, soignants, élus, bénévoles associatifs, État, qui se met en place pour elle, autour d'elle.
Ce combat est donc le nôtre.
Nous devons le poursuivre et nous devons le gagner.
Nous sommes sur une lancée qui est essentielle, déterminante pour notre avenir, pour l'avenir des femmes, l'avenir aussi de nos enfants, qui sont les victimes également de ces violences intrafamiliales et conjugales.
Ensemble, continuons ce combat.
Apparition du cartouche Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations
Liberté
Égalité
Fraternité
Où en sommes nous aujourd'hui ?
Six ans plus tard, des mesures emblématiques et structurantes ont été réalisées :
• Le 3919 est accessible 24h/24, 7j/7 en métropole et en Outre-mer. Depuis 2021, la plateforme téléphonique est accessible aux personnes en situation de handicap (sourdes, malentendantes, aphasiques) et allophones (+ de 200 langues)
En 2024, la plateforme a traité plus de 100 000 appels ;
• Le dépôt de plainte est possible dans 524 établissements de santé, dont 63 intègrent le recueil de preuves sans plainte ;
• En 2024, plus de 4 200 ordonnances de protection ont été prononcées (entre 2017 et 2023, le nombre d’ordonnances de protection délivrées a augmenté de 187 %) ;
• Au 4 juillet 2025, 6 565 téléphones grave danger sont actifs en France, dont plus de 5 200 sont actuellement déployés auprès des victimes (entre 2020 et 2023, le nombre de TGD déployés a augmenté de 483 %) ;
• Plus de 760 bracelets anti-rapprochement sont en cours d’utilisation à la même date. Sur les deux dernières années, 3 700 bracelets ont été déployés ;
• Fin 2024, plus de 11 200 places d’hébergement sont dédiées aux femmes victimes de violence (le nombre de places a plus que doublé depuis 2017).
- De décembre 2023 à octobre 2025, 63 062 personnes ont bénéficié de l’aide universelle d’urgence et le montant moyen des aides versées s’est élevé à 888,46 euros.
Un arsenal législatif nouveau
Un arsenal législatif élargi et renforcé permet de lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes, notamment au sein du couple.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » du 23 novembre 2018 a facilité la mise à l’abri des femmes victimes de violences conjugales en faisant cesser la solidarité entre les locataires.
La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a permis la création du dispositif du bracelet anti-rapprochement et a accéléré la procédure d’obtention de l’ordonnance de protection à six jours.
La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a renforcé de façon significative la protection des victimes en autorisant la levée du secret médical lorsque les violences mettent la vie de la victime en danger immédiat. Le « suicide forcé » est entré dans le Code pénal, reconnu comme circonstance aggravante du délit de harcèlement moral au sein du couple.
La loi du 28 février 2023 a créé une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales sous la forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt sans intérêt. Cette aide va permettre aux victimes qui quittent le foyer conjugal de faire face aux dépenses immédiates en attendant de trouver une solution durable.
La loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales prévoit :
Le retrait total de l’autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime sur son enfant, et en cas de crime commis sur l'autre parent ;
La suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement au parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant ;
La délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s'il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
La suspension des droits de visite et d’hébergement des parents sous contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales.
La loi du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, à la suite du rapport parlementaire « Plan rouge vif - Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales ». Cette loi prévoit notamment de :
Porter à 12 mois la durée initiale des mesures prononcées ;
Masquer l’adresse de la victime sur les listes électorales ;
Permettre au juge de délivrer sous 24 heures une ordonnance provisoire de protection immédiate, en cas de danger grave et imminent. Il peut aussi prononcer plusieurs mesures contre l'auteur présumé des violences : interdiction d'entrer en contact avec la ou les victimes ; interdiction de paraître dans certains lieux (domicile, lieu de travail de la victime...) ; suspension du droit de visite et d'hébergement ; interdiction de détenir une arme et obligation de la remettre aux forces de l'ordre.
Consulter la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille du 28 décembre 2019
Consulter la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales du 30 juillet 2020
Protéger et accompagner les victimes
Faciliter une sortie définitive des violences
En moyenne, les victimes de violences au sein du couple feraient encore 7 allers-retours avant de quitter définitivement leur conjoint violent. La crainte de ne pas disposer de ressources suffisantes, les multiples démarches à entreprendre pour bénéficier d’aides auprès de divers acteurs, les délais d’attente conjugués aux impacts des violences constituent de réels freins à une séparation pérenne avec l’auteur de violences conjugales.
Le Pack nouveau départ est un dispositif expérimental qui a pour objectif de lever ces obstacles, par l’organisation d’une prise en charge rapide et coordonnée des victimes, avec un accompagnement personnalisé à même de répondre à l’ensemble de leurs besoins (ouverture accélérée de droits sociaux, accès au logement, prise en charge sanitaire ou soutien psychologique, réinsertion sociale et professionnelle…). Il repose sur un réseau de référents au sein de structures partenaires institutionnelles et associatives, qui assurent un accompagnement dans des délais optimisés, permettant ainsi à la victime et à ses enfants de retrouver plus rapidement autonomie et sécurité. Le dispositif est déployé actuellement dans le Val-d’Oise, à La Réunion et dans le Lot-et-Garonne. Le dispositif sera prochainement déployé en Côte d’Or et dans les Bouches-du-Rhône.
Créée par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, l’aide universelle d’urgence permet de soutenir financièrement les victimes de violences conjugales afin qu’elles puissent se mettre à l’abri et faire face à leurs dépenses immédiates. Versée en une seule fois dans un délai de trois à cinq jours, elle prend la forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt sans intérêt selon la situation financière et sociale de la personne, ainsi que le nombre d’enfants à sa charge. Plus de 38 000 personnes ont bénéficié de cette aide entre décembre 2023 et décembre 2024.
Pour en savoir plus sur l’Aide universelle d’urgence : CAF et MSA
Les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge
Différents dispositifs sont déployés sur le territoire pour accompagner les femmes victimes de violences au sein du couple :
Les accueils de jour, présents dans une centaine de départements, garantissent un premier accueil et une écoute des femmes victimes de violences, suivis éventuellement d’une orientation vers d’autres structures et partenaires. Ils visent à préparer ou éviter le départ du domicile des femmes victimes de violence et de leurs enfants et à prévenir les situations d’urgence.
Les lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation (LAEO), dont le déploiement a été renforcé, délivrent des informations, un soutien psychologique et un accompagnement dans la durée.
Des dispositifs d’aller vers visent spécifiquement les femmes isolées socialement et/ou géographiquement, en ruralité et en quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin d’améliorer leur accès aux droits et/ou de prévenir et d’accompagner celles qui sont victimes de violences.
Des référents pour les femmes victimes de violences au sein du couple assurent dans une quarantaine de départements une mission de coordination de proximité.
Les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), qui bénéficient d’un agrément délivré par l’État. Les 98 CIDFF proposent des permanences juridiques sur l’ensemble du territoire afin d’informer, orienter et accompagner les femmes dans la connaissance et l’exercice de leurs droits. Les CIDFF sont aussi compétents en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, d’accompagnement vers l’emploi et de prévention des comportements sexistes auprès des enfants et des jeunes.
Améliorer la réponse sanitaire apportée aux femmes victimes de violences
Plusieurs dispositifs sont spécifiquement dédiés à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des femmes victimes de violences :
Les 15 centres régionaux de prise en charge du psycho-traumatisme ;
Les 100 maisons des femmes/santé, structures dédiées à la prise en charge sanitaire, psychologique et sociale des femmes victimes de violences, aujourd’hui ouvertes dans 81 départements ;
Le dépôt de plainte dans les hôpitaux et cliniques, qui est aujourd’hui possible dans 542 structures, grâce à la coordination entre les forces de l’ordre et les directions des établissements hospitaliers, en lien avec les agences régionales de santé.
Prendre en compte des besoins des femmes victimes de violences dans tous les dispositifs d’hébergement et de logement
Depuis 2017, le nombre de places d'hébergement en urgence pour les femmes victimes de violences a plus que doublé, pour atteindre 11 172 places au 31 décembre 2024.
L’isolement géographique ou l’éloignement sont autant de freins à l’accompagnement des victimes. Il est donc indispensable d’assurer un maillage territorial homogène de l’ensemble des dispositifs de prise en charge des victimes. Le plan Toutes et tous égaux prévoit donc de :
D’ici 2027, doter chaque département d’une maison des femmes/santé, structure médico-sociale de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences, adossée à un centre hospitalier, et y généraliser le recueil de plainte ;
Développer « l’aller vers » en renforçant les permanences des associations d’aide aux victimes au sein des Maisons France Services et des Bus France Services, en formant des référents violences et en renforçant la présence des bus itinérants associatifs d’information en zone rurale.
Amplifier le dispositif « téléphone grave danger »
Généralisé en 2015 par le ministère de la Justice et le ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes après une phase d’expérimentation, le téléphone grave danger (TGD) est un téléphone portable disposant d’une touche permettant à la victime de joindre, en cas de grave danger, le service de téléassistance accessible 7j/7 et 24h/24 pour évaluer la situation et permettre l’intervention immédiate des forces de l’ordre. Il permet ainsi de mieux protéger les victimes de violences conjugales, par un accompagnement et un soutien continu, et de prévenir de nouveaux passages à l’acte.
Le dispositif a fait la preuve de son efficacité et le nombre de TGD actifs attribués à des victimes est en constante augmentation : 4 531 TGD avaient été attribués à des victimes en 2023 contre 300 en 2019 et 727 en 2020.
Au 3 janvier 2025, 6 261 téléphones grave danger sont déployés sur le territoire dont 5 066 attribués à des victimes.
Conforter le rôle des intervenants sociaux en commissariats et brigades de gendarmerie (ISCG)
Les femmes victimes de violences qui trouvent le courage d’aller porter plainte doivent être accueillies dans les commissariats et brigades de gendarmeries dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi le réseau des intervenants sociaux en commissariats et brigades de gendarmerie (ISCG) a été renforcé depuis le Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Fin 2024, 481 intervenants sociaux sont en poste dans les commissariats et en gendarmerie.
Créer des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dans les tribunaux
Une justice plus rapide, plus transversale, mieux adaptée aux spécificités des violences conjugales et intrafamiliales est essentielle pour mieux protéger les femmes victimes de violences. Depuis le 1er janvier 2024, des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales ont donc été mis en place dans tous les tribunaux judiciaires et cours d’appel. L’objectif est de pouvoir traiter en transversalité les dossiers de violences intrafamiliales à la fois sur le plan civil (affaires familiales, assistance éducative, autorité parentale…) et sur le plan pénal (pôle mineurs-famille au parquet, audiences correctionnelles) avec un dossier unique et des audiences dédiées.
La complexité et la spécificité des violences conjugales rendent primordiales la formation et la spécialisation des professionnels qui interviennent auprès des victimes de violences conjugales. L’objectif est de mieux évaluer le danger auquel sont exposées ces femmes, et ainsi de mieux les protéger.
Le Plan Toutes et tous égaux prévoit donc de :
Enrichir le fichier de protection des victimes de violences intrafamiliales (FPVIF), pour intégrer des données relatives à la victime afin de mieux évaluer la situation de danger de la victime ;
Accélérer le recours à l’ordonnance de protection en la rendant immédiate dans les 24 heures, conformément à la loi du 13 juin 2024renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate ;
Renforcer la formation des magistrats et de l’ensemble des acteurs de première ligne.
Améliorer l'accompagnement des victimes de violences conjugales dans la sphère professionnelle
Les violences conjugales, si elles relèvent de la vie personnelle, peuvent néanmoins être détectées dans la sphère professionnelle. Si certaines entreprises se sont engagées de façon proactive sur le sujet, le Grenelle des violences conjugales a été l’occasion de renforcer l’accompagnement des victimes de violences dans le monde du travail, grâce à des mesures conduites en partenariat avec le ministère du Travail et le ministère de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification :
Le déblocage de l’épargne salariale de façon anticipée pour les victimes de violences conjugales ;
L’intégration des violences conjugales dans le guide relatif à l’égalité professionnelle à destination des TPE/PME pour leur permettre de mieux détecter et prendre en compte ces situations ;
L’intégration des violences conjugales dans les plans de santé au travail pour renforcer la mobilisation de tous les acteurs ;
La prise en compte des violences conjugales dans le Label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L’accompagnement des entreprises par les CIDFF grâce à un guide méthodologique paru 2022 : « Violences au sein du couple : on en parle au travail ? »
À l’occasion du 25 novembre 2022, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a souhaité mobiliser les acteurs économiques pour lutter – aux côtés des services de l’État et des associations – contre les violences faites aux femmes. De manière inédite, douze entreprises et fédérations professionnelles ont décidé de s’engager avec des actions concrètes.
Prévenir la récidive et prendre en charge les auteurs
La généralisation du bracelet anti-rapprochement (BAR)
Parce que les femmes victimes de violences conjugales sont susceptibles, après leur séparation, d’être menacées par leur ancien conjoint, le bracelet anti-rapprochement a été mis en place en septembre 2020. L’autorité judiciaire prononce cette mesure au civil ou au pénal en définissant un périmètre de protection que l’auteur de violences ne doit pas franchir. S’il pénètre dans cette zone, la victime est prévenue et mise en sécurité, et l’auteur interpellé par les forces de sécurité.
Ce dispositif peut être prononcé en cas d’infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, y compris en l’absence de cohabitation, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime.
Au 8 janvier 2025, 817 BAR étaient ainsi actifs sur le territoire.
Les centres de prise en charge des auteurs
Face à la gravité et à l’ampleur du phénomène des violences au sein du couple, la prévention constitue un enjeu essentiel des politiques publiques sociales, judiciaires et sanitaires.
À l’issue du Grenelle des violences conjugales, le Gouvernement a annoncé la création de centres de prise en charge des auteurs (CPCA) afin de favoriser la prévention du passage à l’acte et de la récidive.
Aujourd’hui, 30 centres proposent une prise en charge globale et pluridisciplinaire des auteurs de violences conjugales, qu’ils soient volontaires ou placés sous-main de justice. Les CPCA ont développé une offre de service comprenant :
Un module dit « socle », correspondant à des actions de responsabilisation de l’auteur, telles que des stages de responsabilisation et des groupes de parole.
Deux modules complémentaires, proposés selon les besoins de l’auteur : un accompagnement psychothérapeutique et médico-social incluant un suivi psychologique et en addictologie si besoin ; et un accompagnement socio-professionnel visant notamment l’accès aux droits et l’insertion professionnelle.
Certains CPCA ont développé des modules supplémentaires ou spécifiques, tels qu’un accompagnement à la parentalité, à l’hébergement, un suivi social renforcé…
Depuis leur création, les CPCA ont pris en charge 44 830 auteurs dont 19 720 auteurs 2023. 13 % d’entre eux sont venus dans le cadre d’une démarche volontaire.
Les plateformes dédiées aux auteurs
Parallèlement, début 2020, alors que la crise sanitaire et le premier confinement augmentaient les risques de violences conjugales dans le huis-clos familial, la question de la prévention, de la protection des victimes et de l’éviction du conjoint violent appelaient des réponses complémentaires. Deux nouveaux dispositifs initiés par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes ont été mis en place dès le mois d’avril 2020 :
Le numéro Ne frappez pas, dédié aux auteurs, aux potentiels auteurs et à leur entourage, porté par la Fédération Nationale des Associations et des Centres de prise en Charge d'Auteurs de Violences conjugales et Familiales - FNACAV
Numéro Ne frappez pas : 0 801 90 1911
Depuis sa création, 1 334 auteurs ont été orientés par cette plateforme téléphonique vers une solution de prise en charge (dont 477 vers un CPCA).
La plateforme de recherche de solutions temporaires d’hébergement des auteurs faisant l’objet d’une procédure d’éviction, pour protéger les femmes et les enfants victimes et leur permettre de rester à domicile, portée par le Groupe SOS.
Aide universelle d'urgence et Pack nouveau départ
Depuis le 1er décembre 2023, les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier d’une aide financière leur permettant de quitter rapidement leur foyer, de se mettre à l'abri et de faire face aux dépenses immédiates.
Aide universelle d’urgence
Toutes les personnes peuvent bénéficier de cette aide (femmes, hommes, avec ou sans enfant) :
- Victimes de violences conjugales qui souhaitent se séparer ou qui sont en cours de séparation ;
- Résidant de manière stable et régulière sur le territoire français, ;
- Quelles que soient leurs conditions de ressources.
Comment en faire la demande ?
La demande est faite par la victime auprès de la caisse d’allocations familiales CAF ou de la mutualité sociale agricole MSA :
- En ligne sur caf.fr en remplissant un formulaire téléchargeable ou sur msa.fr via une demande en ligne ;
- Ou sur place ;
- Ou par voie postale, en remplissant ce même formulaire.
Pour pouvoir être éligible à cette aide financière, il est impératif d’attester des violences subies en présentant une des trois pièces suivantes datant de moins de 12 mois :
- une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ;
- un dépôt de plainte auprès des forces de l'ordre (ou récépissé du procès-verbal) ;
- un signalement adressé au procureur de la République.
L'aide est versée :
- En une seule fois par la caisse de rattachement (CAF ou MSA) ;
- Dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande complète ;
- Sous forme d’une aide non remboursable ou d’un prêt sans intérêt selon les ressources et le nombre d’enfants de moins de 21 ans à la charge du demandeur le mois précédant la demande.
Dans le cas d'un prêt, l’auteur des violences peut être condamné à rembourser les sommes versées au titre d’une peine complémentaire à sa condamnation pour violences conjugales.
Quel est son montant ?
- Le montant de cette aide est de 258,61 € minimum (129,30 € à Mayotte) et varie en fonction des ressources et du nombre d’enfants de moins de 21 ans à la charge du demandeur ;
Par exemple : une personne avec trois enfants à charge de moins de 21 ans et dont les ressources sont inférieures ou égales à la moitié du SMIC net (soit 699 euros par mois) bénéficiera d’une aide de 1398 euros.
- La CAF ou la MSA indiquera le montant et la nature de l’aide (prêt ou aide non remboursable) une fois la demande effectuée ;
- Un simulateur de calcul est à disposition sur le site AVVC ainsi que sur les sites caf.fr et msa.fr ;
- Cette aide n’est pas soumise à des conditions de ressources ;
- Mais son montant sera modulé en fonction des ressources et du nombre d’enfants de moins de 21 ans à la charge du demandeur, le mois précédant la demande.
Cette aide n'est pas imposable. Elle n'est pas prise en compte comme ressources pour la prime d'activité et le droit au revenu de solidarité active, ni pour aucune prestation sociale.
De décembre 2023 à décembre 2024, 38 498 personnes ont bénéficié de l’aide universelle d’urgence et le montant moyen des aides versées s’est élevé à 877 euros.
Le Pack nouveau départ
Le Pack nouveau départ (PND) est un dispositif actuellement testé dans les départements du Lot-et-Garonne, du Val-d’Oise, dans le sud de l’île de La Réunion.
Pour les personnes concernées, le parcours se déroule selon les étapes suivantes :
Étape 1 : On vous propose de bénéficier du Pack nouveau départ
Des professionnels de proximité dans ces territoires (policiers, gendarmes, médecins, psychologues, associations, etc.) sont formés pour vous accompagner si vous souhaitez vous séparer de votre partenaire. Ils vous informent, vous guident et peuvent vous proposer de bénéficier du Pack nouveau départ. En cas d’accord de votre part, ils se chargent de transmettre votre demande à un référent coordinateur.
Étape 2 : On organise votre prise en charge
Ce référent vous contacte dans les cinq jours qui suivent, en toute confidentialité, pour évaluer votre situation et identifier vos besoins, afin d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée.
Étape 3 : On vous accompagne sur la durée
Différents professionnels sont mobilisés pour vous accompagner (Conseil départemental, CAF, MSA, CPAM, France travail, bureau d’aide aux victimes, centres hospitaliers, maisons de protection des familles, associations, etc.).
Le processus d’ouverture de vos droits sociaux est accéléré avec l’activation de toutes les aides nécessaires dans votre vie quotidienne..).
Pour en savoir plus, consultez le site internet : arretonslesviolences.gouv.fr